L’éducation au développement durable de la maternelle au bac : faut-il vraiment se contenter de ‘faire sa part’ ?
|
EN BREF
|
Dans un contexte où les préoccupations environnementales prennent une ampleur croissante, l’éducation au développement durable s’impose de plus en plus au sein des établissements scolaires, allant de la maternelle au lycée. Cependant, cette initiative soulève des questions : se limite-t-on à une approche de responsabilité individuelle en prônant le principe de « faire sa part » ? Ou bien existe-t-il une véritable volonté de transformer les mentalités et les pratiques pour répondre aux enjeux écologiques actuels ? La réalité de l’écologisation de l’école reflète des ambivalences qu’il convient d’explorer afin de comprendre la portée réelle de ces actions éducatives.

Les enjeux de l’éducation à l’environnement
La sensibilisation des élèves aux problématiques environnementales s’inscrit dans un mouvement global visant à intégrer le développement durable dans le cursus scolaire. Depuis plusieurs années, les établissements scolaires mettent en place des dispositifs variés, tels que les écodélégués ou la créaion de structures labellisées « E3D », pour encourager des pratiques durables. Ces initiatives visent à rendre les élèves acteurs de leur propre apprentissage, en les incitant à adopter des comportements écoresponsables au quotidien.
Par exemple, des sorties scolaires en plein air sont de plus en plus fréquentes, permettant aux enfants de découvrir la nature tout en apprenant à la préserver. De plus, des projets collectifs de tri des déchets et de sensibilisation à la biodiversité s’inscrivent dans une approche globale de l’éducation environnementale. Toutefois, au-delà de ces actions concrètes, se pose la question de l’impact réel : les élèves développent-ils une véritable conscience critique face aux enjeux écologiques contemporains, ou se cantonnent-ils à des comportements ponctuels et individuels ? Il est essentiel d’interroger l’efficacité de ces dispositifs et leur capacité à provoquer un changement de fond dans les comportements des jeunes face à la crise écologique.

L’éducation au développement durable : une dynamique en mutation
Le système éducatif français a progressivement intégré des initiatives en faveur de la protection de l’environnement depuis la circulaire de 2004, qui a inscrit l’éducation à l’environnement et au développement durable comme prioritaire. Des dispositifs tels que les éco-délégués et la reconnaissance des établissements en démarches de développement durable, labellisés « E3D », témoignent de cet engagement croissant. En 2013, près de 400 établissements avaient déjà reçu cette labellisation, un chiffre qui a bondi ces dernières années, illustrant l’importance croissante accordée à ces pratiques au sein du milieu scolaire.
En dépit de cette dynamique positive, l’approche éducative actuelle soulève des interrogations quant à son efficacité. Les mesures engagées mettent souvent l’accent sur la responsabilité individuelle, avec un focus sur des actions quotidiennes telles que le tri des déchets ou la réduction de la consommation d’énergie. Cela pourrait potentiellement créer une perception que seuls les geste personnels peuvent avoir un impact significatif, détournant ainsi l’attention des transformations systémiques nécessaires pour répondre aux défis environnementaux. De plus, des études montrent que les élèves, bien qu’informés, continuent d’adopter des comportements peu durables, ce qui interroge l’impact réel de ces initiatives.
Pour renforcer cette analyse, il est crucial de mettre en lumière la perspective des enseignants. Nombreux sont ceux qui plaident pour une approche plus interdisciplinaire qui favoriserait une vision critique des systèmes en place. Ils estiment que la vraie transformation passe non seulement par des actions individuelles, mais par une prise de conscience collective face aux enjeux environnementaux, impliquant des discussions sur les modèles économiques et les structures sociales. L’éducation devrait donc aspirer à équiper les étudiants d’un ensemble de compétences et de savoirs nécessaires pour naviguer dans un monde où les défis environnementaux sont complexes et multiformes.

De plus en plus d’actions et de dispositifs visant à favoriser la protection de l’environnement prennent forme dans le milieu scolaire, bien que cette écologisation révèle certaines ambivalences.
Depuis la circulaire de 2004, l’éducation à l’environnement et au développement durable est devenue un objectif intégré par les acteurs du système éducatif français. Ce cadre a permis une multiplication de dispositifs variés tels que la création des écodélégués en 2009, l’initiative de labellisation des établissements appelée « E3D » (Établissement en Démarche globale de Développement durable) lancée en 2013, et le développement des ateliers pédagogiques de la Fresque du climat depuis 2015.
De plus, un nombre croissant d’enseignants choisissent de donner des cours en extérieur pour éveiller la conscience environnementale chez leurs élèves, une tendance qui s’est intensifiée après la crise sanitaire de 2020.
Cependant, cette dynamique conduit-elle à une véritable « écologisation » des écoles ? Bien que l’intérêt pour l’environnement prenne de l’ampleur, il témoigne également d’une certaine ambivalence puisque les mesures adoptées se limitent souvent à des logiques de responsabilisation individuelle, ce qui en limite les effets. Voici un aperçu de cette situation.
« Faire sa part » : une écologie de la responsabilité individuelle
Les initiatives de sensibilisation des élèves face aux enjeux climatiques se classent sous l’Éducation au Développement durable (EDD). Il est à noter que cette notion a perdu de son essence critique au fil du temps dans le cadre des politiques publiques. Souvent floue, elle finit par justifier un système économique fondé sur la croissance et l’exploitation des ressources, en mettant l’accent sur des actions individuelles légères plutôt que sur des changements systémiques.
Cette tendance s’accompagne aussi d’une évolution vers des termes comme « transition écologique » ou « agroécologique » pour l’enseignement agricole. Bien que ces concepts restent vagues, ils s’imposent dans divers textes officiels, y compris dans l’enseignement supérieur, sans remettre en question les modèles dominants existants.
La conception de l’écologie qui sous-tend les enseignements dans ce domaine place les élèves au centre des responsabilités et des enjeux environnementaux. Les futurs citoyens sont donc censés comprendre les conséquences de leurs actes et modifier leurs comportements à un niveau individuel, en adoptant des « petits gestes quotidiens » selon l’approche des éducateurs.

Les élèves sont ainsi incités à « faire leur part » au lieu de rester inactifs ou de se sentir incapables face aux défis climatiques. En procédant ainsi, cette manière de former des élèves « éco-responsables » implique une vision du futur qui résultera de l’accumulation de petits ajustements individuels, préservant ainsi les structures actuelles. Le changement serait alors basé sur l’imitation des individus déjà engagés pour le climat.
Les enseignements relatifs à l’écologie sont également intégrés dans des projets collectifs et interdisciplinaires valorisant un apprentissage basé sur la pratique. Bien que les enjeux environnementaux soient intrinsèques à de nombreux programmes, il est pertinent de s’interroger sur l’absence d’une discipline spécifiquement dédiée à l’enseignement de l’écologie.
Les éco-délégués : une écologie des « petits gestes »
Présents dans tous les établissements, les éco-délégués reflètent cette double approche mêlant responsabilisation et imitation. Ces élèves représentants font le lien entre les jeunes et le personnel éducatif pour encourager les actions liées au développement durable.
À lire aussi :
Tous les jeunes ne sont pas Greta Thunberg, et ceux qui aspirent à l’être restent bien en peine
La présence des éco-délégués permet aussi de classer les établissements selon leur degré d’engagement, favorisant ainsi une forme de compétition. Cela repose sur l’idée que ces établissements engagés développeront un « leadership », à l’instar des élèves concernés. Cette dynamique de responsabilisation pourrait donc motiver l’ensemble des élèves à s’investir davantage.
Agissant en tant que « leviers du changement », ces éco-délégués obtiennent un diplôme à l’issue de leur parcours scolaire pour attester de leur engagement. Toutefois, l’analyse de leurs actions révèle qu’ils se concentrent finalement sur des pratiques s’inscrivant davantage dans une écologie « des petits gestes » que dans une réflexion critique sur le fonctionnement du monde économique.

Introduit dès la maternelle, le tri des déchets peut être perçu comme une avancée. Les pratiques de tri s’inscrivent dans un cadre qui incite au contact avec la nature à travers des jeux et des activités en extérieur.
Au cours de ces activités, les enfants ramassent les déchets environnants et participent à des initiatives telles que des lectures d’albums ou des ateliers artistiques utilisant des matériaux récupérés. À l’issue de ces apprentissages, les élèves deviennent plus attentifs à la gestion des déchets à l’école. Toutefois, ces approches positionnent les enfants et leurs familles comme des « producteurs » de déchets plutôt qu’en focalisant sur les objectifs de réduction des déchets comme définis dans les politiques environnementales. Malgré des efforts de valorisation des déchets, la quantité générale de déchets en France continue d’augmenter.
L’agroécologie : réduire les pesticides plutôt que de repenser l’agriculture
Depuis 2014, à travers le plan « Enseigner à produire autrement » (EPA), les élèves se formant aux métiers de l’agriculture sont aussi soumis à ces logiques. L’agroécologie a été intégrée dans les cursus des formations sous l’égide du ministère de l’Agriculture suite au Grenelle de l’Environnement en 2009, pour limiter l’utilisation de pesticides.
Cet enseignement, à travers de nombreux projets inter-disciplinaires, ne propose pas une remise en cause du modèle industriel de l’agriculture, mais plutôt une prise en considération du respect de l’environnement comme critère essentiel.
Cela entraîne la mise en œuvre de techniques issues de l’agriculture raisonnée, visant à diminuer le gaspillage d’eau et d’engrais à l’aide de technologies avancées. L’objectif est de fournir aux élèves un éventail de savoir-faire adaptés à différents modèles agricoles, y compris l’agriculture conventionnelle.
Cependant, cette écologisation des formations, mêlée à une numérisation ciblée, se réalise dans des temps limités. Les techniques visant à réduire les pesticides ne rompent pas réellement avec la dépendance des agriculteurs à l’égard de l’industrie agroalimentaire. Ainsi, si l’on observe un processus d’écologisation des dispositifs scolaires, ceux-ci demeurent, comme d’autres initiatives, prisonniers d’une logique d’individualisation qui en réduit singulièrement les effets.
De plus en plus d’actions et de dispositifs en faveur de la protection de l’environnement se développent dans le cadre scolaire. Mais cette écologisation recouvre des ambivalences.
Depuis la circulaire de 2004 qui fait de l’éducation à l’environnement et au développement durable un objectif partagé par les acteurs du système scolaire français, les dispositifs et les actions en la matière se sont multipliés. On peut citer la création des écodélégués en 2009, la labellisation des établissements appelée « E3D » (Établissement en Démarche globale de Développement durable) lancée en 2013 ou encore le développement des ateliers pédagogiques de la Fresque du climat depuis 2015.
Par ailleurs, de plus en plus d’enseignants décident de faire école à l’extérieur pour sensibiliser leurs élèves à l’environnement. Les appels à amplifier ces initiatives ont été nombreux depuis la crise sanitaire du Covid-19 en 2020.
Mais cette dynamique conduit-elle vraiment à une « écologisation » de l’école ? Si l’intérêt pour l’environnement se développe, il témoigne d’une certaine ambivalence dans la mesure où les dispositifs restent enfermés dans des logiques de responsabilisation individuelle limitant leurs effets. Explications.
« Faire sa part » : une écologie de la responsabilité individuelle
Les actions de sensibilisation des élèves aux enjeux climatiques s’inscrivent dans le champ de l’Éducation au Développement durable (EDD). Notons que cette notion a été dépouillée de sa dimension critique au fil de ses usages dans les politiques publiques. Très floue, elle finit par cautionner le maintien d’un système économique basé sur la croissance et l’exploitation des ressources naturelles, en mettant avant tout l’accent sur les actions du quotidien à l’échelle individuelle.
De plus en plus, l’expression est remplacée par d’autres notions, comme celle de « transition écologique » (ou « agroécologique » pour ce qui concerne l’enseignement agricole). Tout aussi floue, celle-ci s’impose dans les textes officiels, y compris dans l’enseignement supérieur et ne remet pas non plus en cause les modèles dominants.
La conception de l’écologie qui sous-tend les enseignements transversaux correspondants place les individus au cœur des responsabilités et des enjeux climatiques. Les citoyens en herbe sont censés prendre conscience des effets de leurs actes personnels sur l’environnement et adapter leurs comportements individuels (en adoptant de « petits gestes au quotidien » selon les termes employés par les enseignants).

« Faire sa part » plutôt que d’être dans un état « passif » ou « d’impuissance » face à la crise climatique semble être l’option privilégiée. Ce faisant, cette manière de former des élèves « éco-responsables » promeut implicitement un futur qui serait l’aboutissement d’une série d’ajustements individuels et progressifs permettant de sauvegarder les structures actuelles. Le changement reposerait sur le mimétisme de ceux qui sont les plus mobilisés en faveur du climat.
Cet enseignement de l’écologie s’inscrit d’ailleurs uniquement dans des projets collectifs et interdisciplinaires qui valorisent un apprentissage essentiellement pratique. Même si les enjeux climatiques sont bien entendu transversaux, on peut s’interroger sur l’absence de création d’une discipline nouvelle spécifiquement dédiée à l’enseignement de l’écologie.
Les éco-délégués : une écologie des « petits gestes »
Désormais présents dans tous les établissements, les éco-délégués font écho à cette double approche de responsabilisation et d’imitation. Ces représentants d’élèves sont placés en position d’intermédiaires (ou des relais) entre les élèves et les professionnels de l’éducation afin de favoriser des démarches qui relèvent du développement durable.
À lire aussi :
Tous les jeunes ne sont pas Greta Thunberg, et ceux qui aspirent à l’être restent bien en peine
Leur présence a été un indicateur permettant de classer les établissements et donc de les mettre en compétition selon leur degré d’engagement dans ce dispositif. Il se fonde sur l’idée que ces établissements engagés vont développer un « leadership », tout comme les élèves engagés. C’est cette responsabilisation de quelques-uns qui permettrait de développer chez l’ensemble des élèves une motivation pour cet engagement.
« Leviers du changement », ces éco-délégués reçoivent un diplôme en quittant le lycée pour attester de leur engagement. Or, l’analyse de leurs actions relève qu’ils soutiennent avant tout des pratiques s’inscrivant dans une écologie « des petits gestes » plutôt que dans une visée critique du fonctionnement du monde économique.

Mis en avant dès la maternelle, le tri des déchets peut également apparaître comme un progrès. Les pratiques de tri s’inscrivent dans la continuité des immersions dans la nature qui favorisent le contact avec les milieux naturels à travers des jeux et des activités à l’air libre.
Durant ces initiations, les enfants ramassent les déchets aux abords des écoles et participent à d’autres activités comme des lectures d’albums, des ateliers artistiques à partir de matériaux non jetés… Après ces activités, les élèves seraient plus attentifs aux déchets à l’école. Mais ces initiations placent les enfants et leur famille comme des « producteurs » des déchets plutôt que de mettre l’accent sur les objectifs de réduction des déchets fixés par les politiques environnementales. Si la valorisation des déchets s’améliore, la quantité de déchets en France ne cesse de croitre.
L’agroécologie : réduire les pesticides plutôt que de repenser l’agriculture
Depuis 2014, avec le plan « Enseigner à produire autrement », les élèves se formant aux métiers dans l’agriculture sont soumis aux mêmes logiques. L’agroécologie s’est développée dans les formations sous la tutelle du ministère de l’Agriculture après le Grenelle de l’Environnement en 2009 dans le but de réduire l’usage des produits phytosanitaires.
Cet enseignement, qui s’inscrit également dans des projets interdisciplinaires, n’implique pas vraiment une remise en question du modèle industriel de l’agriculture mais plutôt une intégration du respect de l’environnement comme un critère à prendre en considération.
Cela conduit notamment au développement de techniques permettant de réduire le gaspillage d’eau et d’engrais à l’aide de machines performantes dotées de capteurs numériques. Il s’agit de présenter aux élèves une palette de savoir-faire qui s’inscrivent dans différents modèles agricoles, y compris l’agriculture conventionnelle.
Mais cette écologisation des formations, conjuguée à une numérisation censée résoudre les problèmes, se fait dans des temps réduits. On enseigne des techniques favorisant une réduction de ces pesticides qui ne permettent pas de rompre avec la dépendance des agriculteurs à l’égard de l’industrie agroalimentaire. Ainsi, on constate bien un processus d’écologisation des dispositifs scolaires, mais, pris là aussi dans une logique d’individualisation, leurs effets sont limités.

L’éducation au développement durable est aujourd’hui intégrée dans le système scolaire français, avec des initiatives comme les écodélégués et des projets interdisciplinaires. Cependant, cette tendance souligne une certaine ambivalence. D’une part, la sensibilisation croissante des élèves aux enjeux environnementaux est essentielle, mais elle semble souvent limitée à des logiques de responsabilisation individuelle, encourageant des gestes quotidiens sans véritable remise en question des modèles économiques en place.
Les dispositifs actuels, bien que prometteurs en surface, mettent l’accent sur des actions à petite échelle, comme le tri des déchets ou la réduction de l’usage de pesticides, sans s’attaquer aux racines systémiques des problèmes environnementaux. Les élèves sont formés à devenir citoyens écoresponsables, mais il est crucial de se demander si cela suffit vraiment face à une crise climatique aux dimensions collectives.
En somme, l’éducation au développement durable doit aller au-delà de simples ajustements individuels. Elle doit viser une véritable transformation des systèmes, incitant ainsi les jeunes générations à penser et agir de manière collective pour un avenir réellement durable.


























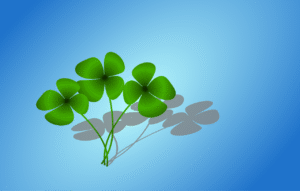



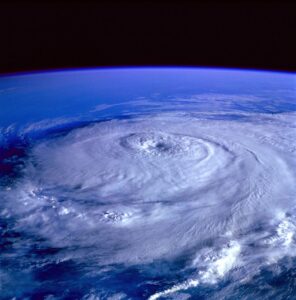


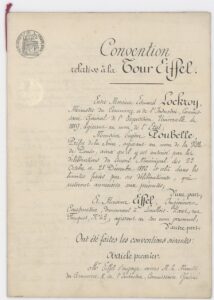
Laisser un commentaire